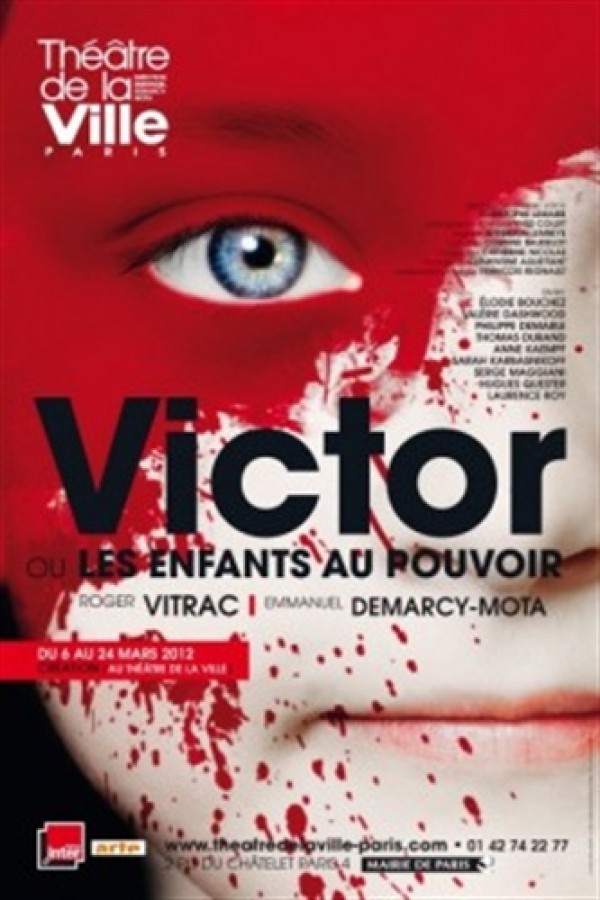Parc de la Villette (plein-air)
Théâtre en container
Théâtre en container
 |
| © khta cie |
mis en scène par Lear Packer et Nicolas Vercken
Ktha
compagnie : Chloé Chamulidrat, Michael Ghent, Laetitia Lafforgue Yann Le Bras,
Camille Lévêque, Guillaume Lucas, Lear Packer, Nicolas Vercken, Camille Voitellier, Mathilde Wahl
« Je suis une personne
Et il m’arrive souvent d’oublier que tu en es une
Je voudrais te le dire
Je suis une personne
Parce que c’est la chose la plus importante pour moi
Et aussi parce que c’est important que tu le saches
Vraiment
Je suis une personne
Chacun de nous est une personne »
Sur l’esplanade de la grande halle de la Villette, un container à deux étages est marqué du nom de KTHA CIE.
Le public prend place sur les gradins, à l’étage de son choix. Face à lui, les deux doubles portes du container sont encore ouvertes (et doivent offrir aux quelques passants de l’esplanade un singulier spectacle : des rangées de personnes dans un container).
Par l’étage du bas entre la comédienne (Camille Voitellier) et la porte du bas se ferme derrière elle. Avec un sourire communicatif qui ne la quittera pas durant toute la représentation, elle observe, ou plutôt plonge son regard dans celui de chaque spectateur.
Pour passer d’un étage à l’autre, elle escalade ou dévale lentement le long des trois parois qui l’entourent. À l’étage, l’espace scénique a pour sol un entrecroisement de poutres métalliques. Elle se tient un instant au mur, se redresse lentement, puis lâche le mur, en équilibre et le regard toujours plongé dans celui d’un spectateur.
Elle raconte tout d’abord son plaisir de danser : ses réticences si elle est la première, puis son plaisir à se laisser entraîner, au milieu des autres, et à ne plus se poser de questions. Elle se tient alors sur le seuil de la porte du haut, restée seule ouverte à moitié, et avance d’un pas dans le vide – ou, du point de vue du spectateur, dans le ciel… La porte se referme.
 |
| © khta cie |
À son retour (miraculeux) par la porte du bas, le dispositif scénographique se
met en place : le container est serti de caméras, et à chaque étage est
projetée l’espace scénique de l’autre étage – de sorte que les spectateurs
puissent suivre la comédienne dans ses déplacements réguliers entre les deux
étages.
Au fur et à mesure des pensées qu’elle égraine au fil de ses circonvolutions, elle semble dresser une sorte d’inventaire des choses qu’elle aime dans la vie, choses parfois si simples, qui semblent lui manquer, et dont elle semble se remémorer après ou pendant un long enfermement.
« Regarder le ciel, les nuages, les oiseaux qui passent, les traces des avions. Je pourrais faire cela des journées entières. »
La nature, les éléments, la ville, les gens, autant de spectacles simples et limpides, mais interdits à qui est reclus entre quatre (pour le théâtre, trois) murs.
Au fur et à mesure des pensées qu’elle égraine au fil de ses circonvolutions, elle semble dresser une sorte d’inventaire des choses qu’elle aime dans la vie, choses parfois si simples, qui semblent lui manquer, et dont elle semble se remémorer après ou pendant un long enfermement.
« Regarder le ciel, les nuages, les oiseaux qui passent, les traces des avions. Je pourrais faire cela des journées entières. »
La nature, les éléments, la ville, les gens, autant de spectacles simples et limpides, mais interdits à qui est reclus entre quatre (pour le théâtre, trois) murs.
Bien qu’induites déjà par le container lui-même, les allusions à l’enfermement
se dessinent d’abord ainsi, en creux par rapport aux images développées, comme
en souvenir d’une liberté, d’une idée d’infini et des joies toutes simples –
sous-entendu : désormais inaccessibles.
Des phrases à l’infinitif que l’on pourrait (que l’on devrait) comprendre à
l’impératif.
« Marcher dans la rue. Aller à la campagne. »
« La pluie. Être sous la pluie. Beaucoup la fuient et courent s’abriter. Pas moi. Je reste sous la pluie, sans capuche. J’aime sentir la pluie sur moi, avoir les cheveux mouillés, lever la tête vers le ciel. (…) Nous étions sous la pluie, dans la rue. Tu t’en souviens ? Tu riais et tu criais « La pluie ! La pluie ! »… La pluie. La pluie... Certains passants riaient aussi, d’autres non. Tu t’en souviens ? »
« Marcher dans la rue. Aller à la campagne. »
« La pluie. Être sous la pluie. Beaucoup la fuient et courent s’abriter. Pas moi. Je reste sous la pluie, sans capuche. J’aime sentir la pluie sur moi, avoir les cheveux mouillés, lever la tête vers le ciel. (…) Nous étions sous la pluie, dans la rue. Tu t’en souviens ? Tu riais et tu criais « La pluie ! La pluie ! »… La pluie. La pluie... Certains passants riaient aussi, d’autres non. Tu t’en souviens ? »
Elle
doit son incarcération à ceux qu’elle se bornera à nommer « les
porcs ». C’est, au fond, à peine si elle leur consacre ses pensées. Elle
ne leur en veut presque pas, elle les plaindrait même, tant elle les trouve
« tristes ».
« Quand je pense à moi, je cours. Je veux dire : quand je m’imagine moi-même, je suis en train de courir. On a tous une image de nous-mêmes en action. Moi, je cours. Et toi ?...
Je cours, je cours vite, je m’enfuis, je m’envole, je décolle presque à chaque pas et retombe pour rebondir.
J’avais presque oublié ce que c’était que courir.
Puis je me le suis rappelé, et je n’arrive plus à penser à autre chose. »
Le récurrent « Et toi ? » donne vie autant qu’il invite.
Donne vie à l’immense espoir d’un personnage enfermé, espoir d’extérieur, de grand air, d’altérité et de réponses ; invite le spectateur à beaucoup d’introspection, à se demander quelles images nous aurions en tête pour conserver l’espoir et, qui plus est, le sourire.
Mais cette occurrence (« Et toi ? ») se personnifie progressivement : une partie de ses pensées articulées s’adresse à sa mère, comme sous forme épistolaire. De toutes les présences, de tous les « autruis » qu’elle pourrait espérer dans la volonté d’altérité qu’elle exprime, c’est cette altérité et ce lien originels, entre une mère et sa fille, qui résonnent plus profondément.
« La sortie des classes. L’heure que l’on appelle « l’heure des mamans ». Ce moment où l’on voit passer tous les enfants. Tu t’en souviens ? Oui, probablement. Ce moment où l’on tient la main de ses parents et où l’on se raconte ce qu’on a fait de sa journée. (…)
Tirer la langue à un enfant dans la rue. On fait tous ça, faire des grimaces aux enfants.
Mais je n’oublie pas de sourire après, car elle pourrait avoir peur et je ne veux pas cela. »
Avec
une agilité sobre et délicate, ses mains frôlent la surface des murs avant de
s’y poser, comme en quête d’un contact symbiotique entre sa peau et leur
matière. – Quite à avoir un contact, si c’est le seul qu’elle peut avoir, pour
le moment…
De plus en plus, l’image filmée et projetée se distord et évolue en netteté, par
moments granuleuse à la manière de caméras de surveillance nocturne. L’image
est ensuite démultipliée informatiquement jusqu’à devenir une mosaïque de plus
en plus fine, décrivant des perspectives infinies, comme si l’on s’écartait à
l’infini d’un point parmi tant d’autres comme lui (comme elle en l’occurrence).
Par leur démultiplication synthétisée, les murs disparaissent presque mais le vertige provoqué accélère la déambulation du personnage enfermé.
À un autre stade, la projection de l’image est comme retardée, de sorte que Camille Voitellier semble suivie par elle-même, ou par l’ombre d’elle-même. Part de désespoir d’un espoir trop pur pour n’être qu’espoir. On peut comme y voir également l’image de celle qu’elle serait sans ces multiples espoirs chevillés au cœur, plus lente, avec ce poids amer qu’elle devrait trainer.
Par leur démultiplication synthétisée, les murs disparaissent presque mais le vertige provoqué accélère la déambulation du personnage enfermé.
À un autre stade, la projection de l’image est comme retardée, de sorte que Camille Voitellier semble suivie par elle-même, ou par l’ombre d’elle-même. Part de désespoir d’un espoir trop pur pour n’être qu’espoir. On peut comme y voir également l’image de celle qu’elle serait sans ces multiples espoirs chevillés au cœur, plus lente, avec ce poids amer qu’elle devrait trainer.
Malgré l’effleurement naïf et peu rancunier dont ils sont l’objet, les murs
sont surtout ceux qui la retiennent, pas si loin mais à l’écart, du monde
extérieur. Ce monde extérieur, cette autre vie derrière ces murs, en qui elle
espère et qu’elle sacralise dans ses aspects les plus simples, naturels et
quotidiens.
Très loin de la nature, le spectacle en est tout de même un hymne, l’espoir confiant qui n’a pas besoin d’un cri, qui dit tout dans son sourire, et tout au fond des yeux.
C’est là le sourire de qui espère et persiste à espérer au-delà des murs, en souvenir de choses éternelles qui transcendent les murs et les individus.
Très loin de la nature, le spectacle en est tout de même un hymne, l’espoir confiant qui n’a pas besoin d’un cri, qui dit tout dans son sourire, et tout au fond des yeux.
C’est là le sourire de qui espère et persiste à espérer au-delà des murs, en souvenir de choses éternelles qui transcendent les murs et les individus.
***
Elle travaille sur des textes qui ne sont pas écrits pour le théâtre, mais des poèmes, des récits, des séries télévisées, des slogans publicitaires, des discours... D'autres textes, qui parlent toujours d'aujourd'hui, d'ici.
Les acteurs s’adressent aux spectateurs, en les regardant dans les yeux, sans détour.
Il y a souvent des projections, des ordinateurs dans les dispositifs scénographiques.
En plus de ses spectacles, la compagnie organise des stages, des ateliers, des laboratoires de recherche…
Elle créé aussi régulièrement des formes courtes, des performances, des lectures, des installations, des expositions… »
Création :
Parvis de la grande halle de la Villette : 14-15 et 21-22 avril 2012
dans le cadre du Festival Hautes tensions - Parc de la Villette
Parvis de la grande halle de la Villette : 14-15 et 21-22 avril 2012
dans le cadre du Festival Hautes tensions - Parc de la Villette
Reprise :
Le Monfort (Paris 15ème arrt.) du 22 mai au 16 juin 2012
(du mardi au jeudi à 21h, vendredi et samedi 19h et 21h) avec la Coopérative de Rue et de Cirque
Le Monfort (Paris 15ème arrt.) du 22 mai au 16 juin 2012
(du mardi au jeudi à 21h, vendredi et samedi 19h et 21h) avec la Coopérative de Rue et de Cirque